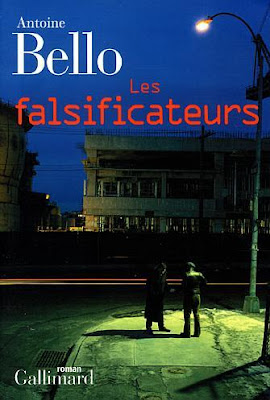-
Jamais un film n’avait été aussi attendu. Alors,
pour marquer ce retour, nous avons nous-aussi voulu faire notre retour…
-
Même si, après notre dernière apparition, tout
le monde nous avait oubliés…
-
Au contraire de « Star Wars
VII » : depuis le rachat de Lucasfilm par Disney en octobre 2012, et
l’annonce de la mise en chantier de ce nouvel épisode, ce film est devenu
l’horizon de toutes les sorties cinématographiques. Lister les raisons qui font
que « Star Wars VII » suscite une telle passion et génère une telle attente
dans le monde entier serait aussi long que sa critique elle-même.
-
Alors… on s’en abstiendra. Aussi parce qu’on
n’est pas particulièrement fan de la saga « Star Wars » – elle a été complètement
sabordée entre 1999 et 2005 par son propre créateur, George Lucas. Après les
trois nanars que sont « La menace fantôme », « L’attaque des
clones » et « La revanche des Sith », elle semblait morte et
enterrée.
-
Mais voilà, en rachetant la saga, Disney a eu deux
excellentes idées qui laissaient augurer du meilleur : virer Lucas de la
création des prochains épisodes, et engager JJ Abrams pour relancer la
franchise, lui qui avait fait renaître de ses cendres « Star Trek ».
-
D’où l’espoir avec « Le réveil de la
force » de voir un film gigantesque, un film-monument. Espoir qui, par la
magie du marketing, a pris des proportions complètement irrationnelles.
-
Ce qui doit aussi participer, quelque part, à notre
déception à la fin de la projection…
-
Soyons clairs : « Le réveil de la
force » n’est pas du tout un mauvais film. La note que nous avons
attribuée au film est là pour le prouver. Mais il est bien loin du choc annoncé
et espéré. En cause : le trop grand respect de ce nouvel épisode à la forme quasi
« canonique » des films « Star Wars ». JJ Abrams et ses
scénaristes ont certes apporté quelques nouveautés mais se sont montrés par
ailleurs si conservateurs sur la forme comme sur le fond que le film a des
allures de compromis permanent.
-
Quelle meilleure illustration pour expliquer ce
compromis entre nouveauté et conservatisme que le scénario de cet épisode
VII ? Il s’agit ni plus ni moins qu’un remake de l’épisode IV de la saga
« Star Wars ». Ainsi, quelques secondes à peine après l’excitation de
constater que j’allais vraiment voir ce fameux épisode VII (l’apparition du premier
carton du film, « Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très
lointaine », a provoqué une salve d’applaudissements et des cris de joie
dans la salle), j’ai été déçu d’apprendre dans le carton défilant que ce nouvel
épisode, et la trilogie qu’il annonce, reproduisait à l’identique le cadre narratif
des épisodes IV, V, VI : il s’agit encore pour un groupe de résistants de
lutter contre une dictature.
-
Comme si « Star Wars » ne pouvait pas
raconter autrement l’éternel combat entre le « Bien » et le
« Mal » ! Seuls les noms ont changé : l’Empire est devenu
le Premier Ordre, et la Rébellion est appelée de manière moins subtile la
Résistance (en règle générale, les références à la Seconde Guerre Mondiale paraissent
plus appuyées dans cet épisode que dans ceux auxquels il fait suite).
-
Exactement ! Le carton n’avait même pas
fini de défiler que j’avais déjà envie de dire à Disney : « Mais
arrêtez de nous rassurer, prenez des risques ! ». « Le réveil de la
force » a été pensé comme un « miroir augmentant » de l’épisode
IV – il s’agit en effet de la même histoire, mais « mise à jour »
avec des variations qui l’améliorent. Pour ne développer qu’un seul
exemple : les deux personnages principaux sont une femme et un noir, ce
qui tranche (et c’est bienvenu) avec l’absence de diversité dans le casting des
épisodes précédents. C’est vraiment très bien fait (pour garder le même
exemple : Daisy Ridley et John Boyega sont excellents, surtout lorsqu’ils
sont ensemble) mais un reflet, même augmenté, ne saurait autant surprendre
qu’une nouveauté.
-
Et tu accuses Disney ? Tu veux croire que
cette idée de reprendre la trame de l’épisode IV a été imposée à Abrams par Disney
pour sécuriser la réception du film auprès des fans… Alors qu’il s’agit
peut-être d’une idée d’Abrams : pour le deuxième film de la nouvelle saga
« Star Trek », « Star Trek intro darkness », il avait déjà
réalisé un remake « en miroir » de la fin de « Star Trek
2 : La colère de Khan ». Le recyclage a toujours été la marque de
fabrique du cinéma d’Abrams mais, poussé à ce point de décalcomanie sur
« Star Wars VII », il redevient une faiblesse plutôt qu’une qualité.
-
Je me pose la même question sur la réalisation
du film. Là aussi, j’espérais plus d’audace : Abrams reproduit très
fidèlement la mise en scène des épisodes « Star Wars ». Le réalisateur
semble s’être effacé derrière les codes visuels et narratifs développés dans la
première trilogie. On se doutait bien qu’il allait garder les transitions si
caractéristiques de « Star Wars »… mais on ne s’attendait quand même
pas à ce qu’il garde la réalisation plan-plan de Lucas pour les scènes d’action.
Le combat au sabre laser final semble ainsi complètement anachronique tant il
est pataud et peu spectaculaire. Quelle était la réelle intention
d’Abrams ? Voulait-il vraiment singer cette réalisation « à
l’ancienne » de Lucas, ou a-t-il été forcé de le faire par Disney ?
-
Ça sent encore le compromis… On pourrait en
outre ajouter l’utilisation de la 3D, très pauvre, Abrams ne jouant presque pas
avec : elle semble vraiment avoir été imposée. Et pourquoi les batailles
spatiales n’ont-elles pas été filmées en HFR ?
-
Cela dit, on fait beaucoup de reproches, mais je
te rappelle qu’on a aimé le film ! On s’exprime en fait sur une déception
par rapport à ce qu’aurait dû être « Star Wars 7 »… Le film tel qu’il
est n’est pas du tout mauvais. La formule « Star Wars » n’a jamais
aussi bien fonctionné, avec un récit mené tambour battant qui ne faiblit pas en
basculant régulièrement sur différents fils narratifs, et accumule les péripéties.
L’humour fonctionne souvent.
-
Surtout, le film use avec intelligence du
« passé » de la saga « Star Wars », devenue avec le temps une
véritable mythologie contemporaine. La meilleure idée des scénaristes est d’avoir
fait coïncider la durée de l’ellipse entre la fin de l’épisode VI et le début
de l’épisode VII avec la durée ayant séparée la sortie des deux films (32 ans).
Les personnages de la première trilogie réapparaissent donc dans cet épisode
VII, ce qui provoque une certaine émotion, grandement avivée par le fait que
les acteurs les interprétant ont vieilli « en vrai » de trente ans !
De la même manière, le film fait se confondre la mythologie créée par la
première trilogie dans notre société avec celle dans laquelle vivent les
personnages du film. Les événements racontés dans les épisodes IV, V, VI sont
devenus des légendes pour les nouveaux personnages de l’épisode VII. Rey vit
ainsi dans les ruines de l’épisode VI (superbes décors) et pense, comme tout
spectateur de « Star Wars », que Luke Skylwalker est un mythe. Lorsqu’on
lui apprend que celui-ci existe bel et bien et qu’on lui assure que la Force
existe, ces informations résonnent avec les propres rêves du spectateur, les chargeant
d’un poids émotionnel que seul le temps a pu créer.
-
L’idée de faire de la recherche de Luke
Skylwalker le point focal du scénario, et de retarder son apparition jusqu’aux
dernières secondes du film est donc très fort, cette idée jouant habilement
avec la disparition médiatique de l’acteur Mark Hamill depuis trente ans. Lorsqu’on
retrouve à la toute fin son regard qui ne veut rien dire, on se dit qu’il n’est
toujours pas meilleur acteur… mais on est quand même très content de le revoir !
-
Il est dommage que ce travail sur le temps passé
qui multiplie les correspondances entre l’histoire du film et l’histoire du spectateur
soit la seule nouveauté apportée à la saga « Star Wars ». Pour le
reste, comme tu l’as dit, tout est tellement semblable voire copié sur les épisodes IV, V, VI, et le
IV en particulier… Jusqu’à la musique, qui ne propose aucun nouveau thème fort !
John Williams s’était pourtant montré bien plus expérimentateur sur la deuxième
trilogie.
-
Lorsque ce sont des qualités qui sont copiées –
tels les effets spéciaux « à l’ancienne », la direction artistique
magnifique, l’humour, la fantaisie, le rythme – ça ressemble à un travail peu
risqué mais terriblement efficace, mais lorsque ce sont des défauts à la saga qui
sont eux-aussi copiés (le « reflet augmenté » n’est en effet pas
parfait), ce conservatisme est regrettable. Pour n’en citer que deux : la
psychologie des personnages est toujours aussi peu subtile…
-
… Ah ! Ce Stromtrooper qui devient
subitement gentil, une belle idée mais que le film rend très dure à avaler.
-
… et cet épisode est aussi prude que les précédents,
avec cette histoire d’amour qui évidemment ne dit pas son nom entre Rey et Finn…
C’est ridicule, et on a l’impression qu’Abrams sait que nous savons qu’il sait,
mais il le fait quand même…
-
Je crois qu’il est temps de conclure, même si je
voulais encore revenir sur plein de détails, le fait que tu sortes une telle
phrase dénote un échauffement excessif de ton esprit. Calme-toi. Ne tombe pas
dans le regret. On a dit qu’on avait aimé le film.
-
Que je me calme ? Alors qu’un nouveau film
sort dans un an ? Et encore un autre après, au moins jusqu’en 2019 ?
Comment veux-tu que je me calme ?
(Bruits de lutte)
On retiendra…
Le fascinant et émouvant
travail sur le temps écoulé entre les épisodes VI et VII, dans la vraie vie
comme dans l’histoire de « Star Wars ».
On oubliera…
L’absence d’audace dans l’écriture
du scénario comme dans la réalisation de ce septième épisode calqué, certes « en
mieux », sur l’épisode IV.
« Star Wars, le réveil de
la Force » de JJ Abrams, avec Daisy Ridley, John Boyega, Harrisson Ford,…